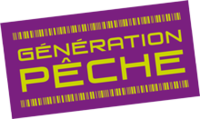Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au site
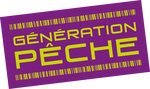
generationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au site
Trouvez les informations pêche de votre département
Accéder au site
cartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au site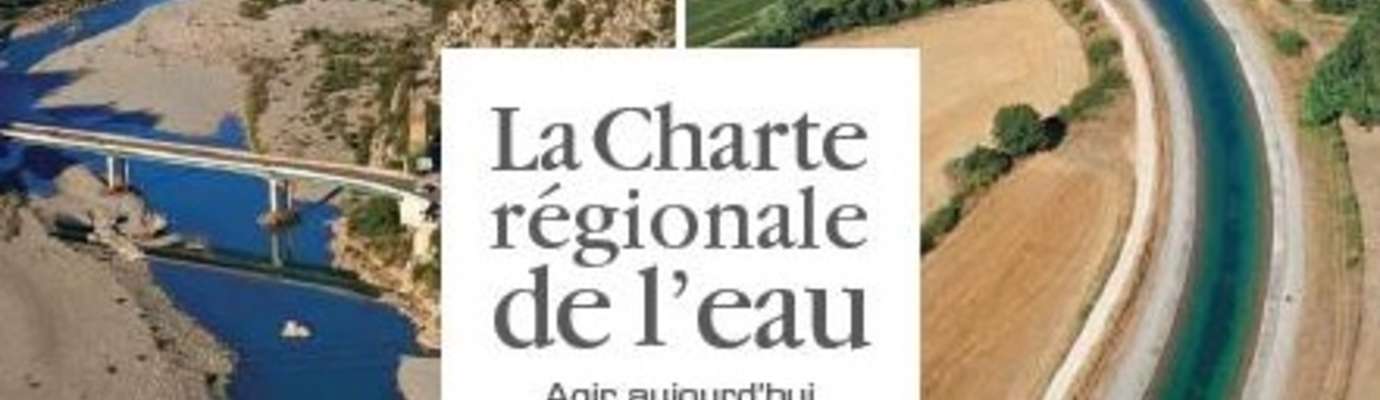
Charte régionale de l'eau
Historiquement, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le développement des activités économiques s’est construit autour de la gestion de la ressource en eau.
Pour anticiper les changements à venir, la Région a initié depuis 2009, en partenariat avec l’Etat et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, une réflexion stratégique et s’est engagée dans une démarche: le SOURSE (Schéma d'Orientations pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la ressource en Eau).
A l'issue du SOURSE, une charte régionale de l'eau a été créée et approuvée par une centaine d'acteurs dont les 6 Fédérations départementales et l'Association Régionale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de Provence Alpes Côte d'Azur.
Suite à la Loi NOTRe La Région Sud a souhaité et sollicité la mission d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, qu'elle a finalement obtenue par décret ministériel le 9 Juillet 2018.
C'est donc afin de mieux redéfinir collégialement cette compétence que la Région a souhaité révisé la charte régionale de l'eau.
Mi-mai à mi-juillet 2019 : révision de la charte régionale de l'eau par le biais de 8 ateliers territoriaux
Afin de recueillir la parole des acteurs de la région Provence Alpes Côte d'Azur pour définir collectivement ces missions d’animation et de concertation, huit réunions territoriales ont été organisées sous la présidence de Philippe VITEL, Vice-Président de la Région Sud et Président de l’AGORA, de la mi-mai à la mi-juillet 2019.
- Malijai - 14 Mai 2019 : atelier territorial « Moyenne Durance Luberon » consacré à l’adaptation des territoires ruraux déficitaires aux changements climatiques et à la mise en œuvre des Plans de Gestion de la Ressource en Eau. Lors de cet atelier, deux thématiques ont été abordées : possibilités d'adaptation de l'agriculture irriguée comme de l'alimentation en eau potable et accompagnement des porteurs de projets dans la réalisation des actions à mettre en oeuvre au niveau des PGRE.
Ce qu'il en est ressorti à notre sens :
- les 8 PGRE validés ou en cours de validation sur ce territoire sont abordés selon uniquement 2 volets : Eau potable & Agriculture. Pour autant, il nous semble important de rappeler que ces PGRE sont issus d'études d’évaluation des volumes prélevables globaux (EVPG) qui constituent la première étape de l’élaboration de PGRE. Ces études doivent apporter les éléments techniques de diagnostic de la situation pour chaque bassin versant ou aquifère et préciser l’ampleur du déficit quantitatif. Elles doivent également proposer des objectifs de débits ou de niveaux piézométriques ainsi que des volumes prélevables globaux permettant d’atteindre le bon état des eaux et de satisfaire l’ensemble des usages en moyenne huit années sur dix. Elles doivent aussi proposer des scénarios visant à résorber les déséquilibres quantitatifs avérés et des pistes d’actions. A notre sens, il aurait été bien qu'un éclairage sur les besoins des milieux aquatiques soit donc également réalisé, quand bien même les PGRE sont faits en ce sens ;
- sur le volet Eau potable : le transfert de compétence obligatoire uniquement pour les communautés d'agglomération au 1er Janvier 2020 (transfert potentiel jusqu'en 2026 pour les autres) peut être un point de blocage selon les secteurs concernés dans la mise en place d'actions concrètes. Avant de travailler à l'échelle d'actions PGRE il est important d'avoir un schéma directeur d'eau potable récent (moins de 10 ans). Ce qui fait défaut c'est aussi un non respect de la réglementation en vigueur : les budgets de l'eau et de l'assainissement doivent être bien distincts de ceux de fonctionnement de la collectivité compétente en la matière afin de s'autosuffire et doivent aussi prendre en compte les amortissements afin de prévoir les provisions nécessaires à la modernisation des réseaux (augmentation des rendements par exemple). Cela passe aussi par la volonté politique de mettre en place une tarification de l'eau différente selon l'usage et le volume prélevé. Enfin, il est nécessaire qu'un animateur territorial soit bien identifié afin de transmettre l'état de connaissances sur la thématique à l'échelle de l'ensemble du territoire mais aussi d'être là pour appuyer techniquement les porteurs de projets potentiels ;
- sur le volet Agriculture : le manque de structuration des ASA et le manque de moyens financiers et humains voire technique sont mis en évidence comme étant de forts points de blocage dans la mise en place d'actions concrètes. Le partage d'expériences/projets aboutis à l'échelle régionale pourrait permettre un essor de projets. Pour autant, le monde agricole se dit être force de propositions et rappelle que des actions volontaires et spontanées d'économies d'eau ont été mises en oeuvre sur le territoire afin de réduire les prélèvements d'eau actuels. Le futur SAGE Durance est aussi pointé du doigt comme étant un outil adapté pour travailler sur le volet gestion quantitative de la ressource en eau et solidarité amont/aval entre territoires à ressource en eau maîtrisée et non maîtrisée. Afin de faciliter l'émergence de projets, le monde agricole souhaite aussi que les procédures de demandes de subventions FEADER soient allégées pour les projets moins importants et certains souhaitent aussi que la réglementation soit simplifiée en faveur de projets d'investissements. La solidarité entre filières agricoles a aussi été abordée. La nécessité de continuer à accompagner les acteurs à faire des investissements a été mise en lumière mais à condition que ces investissements soient collectifs et structurants et qu'ils tiennent compte de l'impact des différents usages ainsi que de la rentabilité des différentes filières agricoles. La nécessité de privilégier le financement de petits projets de goutte à goutte efficients plutôt que le financement de gros projets de retenues ou de réseaux a été évoquée. Enfin, un consensus a été trouvé sur le fait qu'un certain nombre de cultures non patrimoniales régionales doit être abandonné, notamment au regard de l'impact du changement climatique (ex. le maïs).
Enfin, pour un certain nombre d'acteurs (agriculteurs et collectivités territoriales notamment) l'impact du changement climatique en région Provence Alpes Côte d'Azur reste à prouver et les modèles de prévisions à préciser. Pour autant, il existe un groupement d'experts régional sur ce sujet : le GREC PACA et l'impact du changement climatique est déjà perceptible sur le territoire régional. Ce qui démontre encore de la part de certains acteurs une méconnaissance voire un déni flagrant.
- Saint-Chamas - 21 Mai 2019 : atelier territorial consacré à des réflexions pour l’amélioration de la qualité écologique des milieux aquatiques du complexe lagunaire de l'étang de Berre. Au début du 20ème siècle, cet étang était un milieu écologiquement riche. Le pourtour de l’Etang a connu un développement industriel et urbain très important, auquel s’est rajoutée, à partir de 1966, la mise en service des usines hydroélectriques EDF. Cette mise en service a entraîné une perturbation radicale de l'écosystème lagunaire par l'apport massif d'eau douce et de limon en provenance de la Durance. Depuis la fin des années 90, les acteurs locaux se sont mobilisés pour élaborer un programme global de réhabilitation de ce milieu complexe et fragile, considéré comme « le poumon bleu des Bouches du Rhône ». Par ailleurs, dès 2005, les rejets annuels accordés à EDF sont passés de 2,1 milliards de m3 à 1,2 milliards de m3 avec une obligation de lissage, suite à une condamnation de la France par la Cour Européenne de justice. En dépit d’une mobilisation collective, l’écosystème de l’Etang de Berre reste très dépendant des conditions climatiques et des apports extérieurs. Dès lors, l'atelier devait permettre d'évaluer comment appréhender les capacités de l’Etang à absorber ces flux et diminuer les risques de modification de son écosystème et de voir quelles pourraient être les solutions alternatives pour préserver la biodiversité remarquable. Il semblerait que cet atelier ait montré les limites de consensus entre développement économique du territoire d'une part et enjeux environnementaux d'autre part.
- Savines-le-lac - 28 Mai 2019 : atelier territorial Haute Durance/Drac/Ubaye consacré à des réflexions pour l’élaboration d’une stratégie d’adaptation des territoires des Alpes du Sud au changement climatique, principalement sur le volet de la disponibilité de la ressource en eau. Le territoire des Alpes du Sud présente la particularité d’être un espace peu densément peuplé, dont une part importante de l’économie locale repose sur des richesses environnementales fragiles. Dans le même temps, en tant que « château d’eau » de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il contribue significativement au développement de l’ensemble du territoire régional, ce qui renvoie à la nécessité de l’organisation de solidarités interterritoriales. Le changement climatique amène nécessairement les territoires à s’adapter. Dans des territoires plus ruraux comme ceux de la Haute-Durance, du Drac et de l’Ubaye cette adaptation peut être plus complexe à mettre en œuvre. En effet, l’absence de grands ouvrages de sécurisation des ressources en eau, la faible capacité d’investissement des collectivités, la difficulté d’accès à certains financements publics sont des éléments de nature à entraver cette adaptation. Par ailleurs, l’état des connaissances de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau doit être mieux partagé et approprié par la sphère publique. Il doit à la fois mettre en lumière les enjeux sur ce territoire, peut-être trop souvent considéré comme « épargné » par les questions de gestion quantitative (à l’exception de certains bassins versants), et éclairer les choix politiques en matière d’aménagement et de développement du territoire. L'atelier avait donc pour objet de répondre à deux grandes interrogations : Comment le territoire des Alpes du Sud peut-t-il rendre plus lisibles ses enjeux face au changement climatique et comment les défendre et les valoriser dans le cadre de l’organisation de solidarités interterritoriales ? Comment porter ces orientations politiques dans le cadre des futures contractualisations de massif afin que les investissements liés à cette adaptation puissent faire l’objet de financements ? La Fédération de Pêche des Hautes Alpes présente à cet atelier a tenu à s'exprimer sur le développement attendu par bons nombres d'acteurs de retenues collinaires ou de substitution, en les alertant sur le fait qu'il existe différents types de retenues collinaires et que bon nombre d'entre elles sont faites par pompage dans le cours d'eau ou la nappe ce qui va engendrer une pression supplémentaire sur les milieux aquatiques et leur biodiversité, pression qui sera d'autant plus marquée en cumulant les impacts d'un certain nombre de projets qui pourraient voir le jour à l'échelle d'un bassin versant.
- Nice - 11 Juin 2019 : atelier territorial des bassins maralpins consacré à leur sécurisation vis à vis de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique et aux outils d'aménagement et de planification permettant une meilleure protection des ressources en eau souterraines stratégiques. La Fédération de Pêche des Alpes Maritimes était là pour partager son expertise sur ces sujets avec la vision de besoins des milieux aquatiques également à prendre en compte dans ces discussions.
- Avignon - 24 Juin 2019 : atelier territorial Rhône - Camargue consacré aux modes de gouvernance entre les territoires dépendants de la ressource Rhône et besoins de nouvelles structures de gestion pour les eaux souterraines. Sur le premier sujet, lors de l'élaboration du SOURSE, la question de la solidarité amont/aval pour la ressource du Rhône n'avait pas été évoquée car la Région jugeait à l'époque que les besoins ne s'en faisaient pas ressentir. Aujourd'hui, du fait notamment de la volonté du monde agricole de prélever pour le Nord du Vaucluse de l'eau du Rhône pour de grands projets territoriaux, la gestion quantitative du Rhône est enfin prise en considération. Pour autant, nous pensons que cela est encore insuffisant car le Rhône ne doit pas être uniquement étudié sous l'enjeu quantitatif de la ressource en eau mais également qualitatif et environnemental. Deux thématiques qui, comme à chaque fois, sont mises de côté et peu ou pas abordées. Dans le cadre du projet HPR mené par la chambre d'agriculture de Vaucluse, le Préfet de Vaucluse a demandé à cette dernière d'évaluer l'état des connaissances de prélèvements de l'eau du Rhône pour l'irrigation afin de voir si ce projet était viable sur le long terme compte tenu de l'impact du changement climatique et de l'augmentation des besoins anthropiques. Ainsi, la chambre d'agriculture de Vaucluse aurait soulevé le manque de précision des prélèvements de l'eau du Rhône pour l'irrigation en temps réel, ne lui permettant pas d'aboutir à des conclusions fiables quant à l'étude demandée par le Préfet de Vaucluse. Elle pense également que le débit total d'équipement de prélèvement souhaité pour ce projet reste marginal compte-tenu des débits du Rhône et reste septique sur l'impact du changement climatique sur la variation des débits du Rhône. De nombreux acteurs ont tenu à réagir face à ces propos, expliquant que la Camargue notamment avait déjà été impactée par une modification de la dynamique fluviale du Rhône, qui est donc bien déjà en cours, notamment en période d'étiage marqué comme en 2017. Les chroniques de débits du Rhône, qui existent bien, montrent notamment que les 3 débits d'étiage les plus impactants l'ont été lors de la dernière décennie. Quant aux modèles de prévision de l'évolution des débits du Rhône et d'augmentation des températures, ils ne sont pas plus optimistes. Il est donc important avant toute validation de nouveaux projets de prélèvements dans le Rhône de bien prendre en compte tous les usages et les besoins des milieux aquatiques aussi sources de biodiversité et d'un certain nombre de services rendus qui sont encore une fois laissés pour compte. D'autant qu'une diminution des débits et une augmentation de la température va avoir des impacts directs sur les milieux aquatiques et leur biodiversité. Sur le second sujet, le SYMCRAU est intervenu pour démontrer le flou juridique existant sur le fondement de l'implication des collectivités territoriales dans la gestion des ressources en eau souterraines. Le but étant de construire une compétence décentralisée en lien avec le grand cycle de l'eau visant la gestion de la ressource en eau et plus particulièrement des ressources en eau souterraines. Il a ainsi pu évoquer la nécessité d'intégrer la gestion de la ressource en eau brute dans le service de l'eau potable. Ces propositions, notamment d'évolution du cadre réglementaire, a fait l'objet de propositions soumises aux Assises Nationales de l'Eau qui sont en train de se finir. Il apparaît également sur ce sujet qu'il y a encore un manque de connaissances du fonctionnement de ces ressources souterraines qui induit sûrement un manque d'adhésion d'actions. Pour autant, les PGRE du Lez, de l'Aygue ou encore de l'Ouvèze vont induire un transfert de pression sur les ressources en eau souterraines pour lequel il va donc falloir mettre les moyens afin de sécuriser à minima dans un premier temps les ressources souterraines régionales dites stratégiques, comme la Crau par exemple. La nécessité de sensibiliser l'ensemble des EPCI à fiscalité propre et syndicats à ces enjeux a été formulée, que ces derniers soient directement concernés ou pas, dans un souci de gestion intégrée des ressources en eau souterraines. Pour autant, là encore ce n'est que sous le regard d'enjeux anthropiques que ces ressources sont étudiées alors même qu'elles présentent aussi de grands intérêts pour la préservation des milieux aquatiques (zones refuges, notamment en têtes de bassin comme sur les Sorgues, soutien au débit d'étiage en période estivale etc.). Enfin, pour lever les barrières de périmètre, il est envisagé selon les secteurs concernés de mettre en place des EPTB (cas des Sorgues mentionné par exemple).
-
Sénas - 8 Juillet 2019 : atelier territorial basse Durance - Crau consacré aux outils disponibles pour une amélioration de la protection des ressources en eau souterraines stratégiques dans les documents de planification et d'aménagement et aux contributions des multiples bénéficiaires directs et indirects du transport d'eau par les canaux. Là encore, nous nous interrogeons sincèrement sur la place accordée aux milieux aquatiques et à leur biodiversité dans cet atelier... Et ce alors même que les missions d'animation et de concertation, confiées par l'Etat à la Région Sud par décret ministériel, portent bien sur la gestion et la protection de la ressource en eau ET des milieux aquatiques et que la Région Sud a souhaité être chef de filât sur la Biodiversité, donc à fortiori sur la biodiversité aquatique aussi. En effet, on ne peut que constater, malheureusement dans cet atelier, que la ressource en eau est encore vue comme un contenant vide de toute vie et que l'on confronte toujours aux mêmes usages (eau potable et agriculture) alors même qu'il en existe d'autres (dont la pêche de loisir en eau douce qui représente plus de 42 Millions d'euros d'impact économique en région Provence Alpes Côte d'Azur).
Pour autant, le territoire de la basse Durance est un territoire fortement artificialisé et anthropisé, avec des conséquences non négligeables pour les milieux aquatiques et leur biodiversité (dont les 2 espèces migratrices emblématiques que sont l'Anguille européenne et l'Alose feinte du Rhône mais aussi l'Apron du Rhône, le Barbeau Méridional, le Brochet, la Truite autant d'espèces piscicoles protégées et/ou patrimoniales) qu'il est important de prendre en considération et sur lesquelles il aurait aussi été bon de se questionner : restauration hydromorphologique du cours d'eau ? Restauration écologique du cours d'eau ? Gestion de la transparence en crue ? Gestion de la ressource en eau superficielle ? Sur ce dernier sujet, le SMADESEP a dû réunir les membres de son Bureau en urgence pour voir comment agir face à une retenue qui n'est pas à sa côte optimale, du fait d'un cumul d'une fonte de neige tardive et d'une demande en eau des agriculteurs très importante pour la saison en aval... Sur les deux sujets abordés nous nous posons aussi des questions : pourquoi rechercher des solutions d'urbanisme et d'aménagement en faveur des ressources en eau souterraines alors qu'un guide de l'aménageur vient de paraître sur "les eaux souterraines au coeur de l'urbanisme - un atout pour les territoires de Provence Alpes Côte d'Azur", guide publié par l'ARPE-ARB en lien avec le BRGM et financé par la Région Sud et l'Agence de l'Eau RMC... Il semblerait que le problème ne vienne pas d'un manque d'outils mais plutôt d'un manque de volonté politique à agir et d'un choix entre différents modèles économiques se présentant à nous. D'ailleurs, pour rappel à ce sujet, la protection des eaux souterraines constitue une priorité de la politique environnementale française et de l'UE notamment parce qu'elles fournissent le débit de base de nombreux fleuves et qu'elles servent aussi de tampon en période de sécheresse et sont essentielles pour conserver les zones humides. C'est bien le cas en basse Durance et en Crau et çà serait bien que cet aspect là ne soit pas mis de côté. Quant au deuxième sujet abordé, doit-on comprendre que nous devrions tous contribuer financièrement au fonctionnement ou aux investissements faits par les acteurs de canaux ??!! Doit-on comprendre qu'il vaut mieux continuer à laisser des fuites sur les canaux parce qu'ils contribuent à recharger les nappes ? Il ne faudrait peut être pas oublier, là encore, que l'eau issue des canaux est de l'eau détournée de la Durance... De l'eau qui manque à la rivière pour maintenir la température de son cours d'eau et ne pas avoir un débit d'étiage trop marqué voire concourant à un assec. Que c'est tout un patrimoine piscicole qui s'y retrouve "coincé", entraînant des pêches de sauvetage réalisées par nos Fédérations de Pêche lors des mises en chômage de ces derniers. L'espace de loisir et le cadre paysager seraient en effet bien différents si les canaux n'existaient pas... Ils seraient plus naturels, en lien avec les milieux aquatiques rencontrés. L'idée n'est pas là de dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de canaux d'irrigation du tout, mais si nous pouvons entendre les bienfaits des canaux pour le monde agricole nous ne pouvons l'entendre sur les autres aspects évoqués, car ce ne sont que des résultantes qui profitent au monde agricole et pas l'inverse.
- Le Castellet - 15 Juillet 2019 : atelier territorial métropoles MPM et Toulon consacré exclusivement à la gestion des ressources en eau souterraines sous 3 aspects déjà évoqués dans divers ateliers territoriaux, à savoir : la sécurisation et la diversification des ressources utilisées pour l'eau potable notamment de ces 2 métropoles, la gouvernance à mettre en oeuvre et les outils de planification et d'aménagement pour une meilleure préservation de ces ressources.
Il va falloir trouver des équilibres entre ressources locales et ressources de transfert. La mise en place d'Observatoires (comme celui existant dans le Var et piloté par le Conseil Départemental) a été évoquée. Tout comme la question de la tarification de l'eau et le besoin d'améliorer la connaissance du fonctionnement des aquifères. La sécurisation de l'alimentation en eau potable peut se faire par le biais de différents maillages et territoires, à l'image de ce qui est en cours sur la ville d'Aix-en-Provence. Les guides usagers/aménageurs mis en place par le SYMCRAU peuvent faire référence en termes d'actions de communication pour une meilleure prise en compte de la protection de ces ressources dites stratégiques. La qualité de l'eau peut être un facteur limitant, de même que la question du foncier. La vulnérabilité future de la ressource doit aussi être prise en compte. Il y a aussi un besoin fort d'animation sur la sensibilisation de l'ensemble des usagers de l'eau aux services connexes de la ressource en eau (urbanisme, milieux aquatiques et cadre de vie etc.). La sécurisation de la disponibilité de la ressource en eau passe avant tout par une sobriété que nous devons tous partager car facile à mettre en oeuvre et sans regret. La question de la gouvernance reste entière. S'il y a besoin effectivement de savoir qui met en oeuvre cette politique, qui organise cette répartition de la ressource, qui régule les tensions entre les usages, il n'y a pas un acteur parmi d'autres qui ressort mais une multitude d'acteurs qui peuvent agir à différentes échelles (syndicats mixtes, métropoles, SCP, Région Sud etc.). Il y aura donc des choix à faire dans un futur proche et ne pas oublier aussi d'intégrer la gestion des milieux aquatiques dans cette approche. Un zoom à l’échelle du projet d’aménagement a également été fait avec mise en avant de la nécessité de réaliser un travail en commun et le plus transversal possible (études hydrauliques, permis de construire etc.). La question de la connaissance au sens large (capacité des nappes, des canaux etc.) avec la problématique des périmètres des zones de nappes souterraines différentes des cours d’eau a aussi été abordée. Il a également été rappelé que les outils réglementaires existent mais qu'ils ont aussi leurs limites (un SAGE peut-il par exemple intégrer les ressources en eau souterraines dans son règlement, notamment si celles-ci dépassent l'échelle administrative ou l'échelle du bassin versant?). Enfin, l'incitation à la réutilisation des eaux usées a aussi été évoquée. De même que la conditionnalité d'aide de l'Agence de l'Eau.
- Draguignan - 18 Juillet 2019 : atelier territorial Verdon/Argens et Golfe de Saint Tropez consacré aux conditions d’adaptation durable des usages au changement climatique et aux enjeux de solidarités entre les territoires du Verdon, de l’Argens et du Golfe de Saint-Tropez sur la gestion des ressources en eau pour répondre au développement touristique de ces territoires et aux pics saisonniers de consommation d’eau et aux nouveaux besoins d’irrigation et au développement de projets de territoires durables agricoles dans un cadre de préservation de la qualité des ressources en eau. En plus de l'ARFPPMA PACA, la Fédération de Pêche du Var, représentée par son Président Louis FONTICELLI (également Trésorier de l'ARFPPMA PACA).Les bassins versants de ce territoire sont dès aujourd'hui pour certains en déséquilibre quantitatif ou sont en équilibre fragile au regard des effets du changement climatique. Ce territoire dispose d’aquifères considérés ressources stratégiques par le SDAGE dont certains connaissent déjà des problématiques de gestion quantitative. Les possibilités de diversification des ressources peuvent être limitées et dépendent des situations locales. L’attractivité touristique de ces territoires entraîne des pics de consommation ou de besoins en période estivale, qui sont parfois difficiles à gérer. Des démarches ont été engagées pour limiter les consommations d’eau auprès de différents usagers (campings, hébergements touristiques…) avec des résultats divers. La plupart des masses d’eau du territoire Verdon/Argens/Golfe de St Tropez connaissent d’ores et déjà des tensions avérées en matière de gestion quantitative de la ressource en eau, tensions qui vont s’accentuer à l’avenir avec le développement démographique, l’urbanisation et l’apparition de nouveaux besoins en matière d’irrigation agricole, et ceci dans un contexte de changement climatique qui pèse sur les ressources disponibles. Des enjeux de reconquête de la qualité de l’eau et de la biodiversité aquatique sont déjà présents sur certaines masses d’eau. Les transferts d’eau à partir de la ressource Verdon permettent de sécuriser ces territoires et d’alléger la pression actuelle sur les ressources locales. Toutefois, ces transferts d’eau doivent s’accompagner d’une incitation à la maîtrise des besoins en eau, notamment en matière d’irrigation agricole, pour ne pas trop peser sur la ressource et ne pas aggraver les équilibres fragiles de certains sous bassins du Verdon. C'est véritablement l'atelier où les enjeux propres aux milieux aquatiques et au maintien voire à la reconquête de leur biodiversité ont été les mieux et les plus abordés, de même que les enjeux de reconquête de la qualité des eaux et d'atteinte du bon état des masses d'eau, permettant ainsi d'avoir une vision globale pour une gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, telle que nous aurions dû l'appréhender, à notre sens, dans les différents ateliers territoriaux. La présence de Jacques ESPITALIER n'y est sûrement pas pour rien dans cet éclairage. Ce dernier a en effet tenu à alerter les acteurs réunis pour cet atelier sur le fait que nous allons devoir faire des choix en matière d’aménagement du territoire, d’économie au vue de notre environnement, des services rendus et du réchauffement climatique qui va accroître les tensions. Car, si aujourd’hui, en Provence Alpes Côte d'Azur, il est possible que les grands aménagements structurants de gestion de la ressource en eau qui ont été mis en place par le passé nous permettent de plutôt bien gérer la ressource en eau, dans l’avenir, selon les choix économiques et touristiques que nous ferons cela ne sera sûrement plus le cas. On le voit sur le territoire du Verdon déjà à l’heure actuelle : équilibre fragile voire déséquilibre quantitatif selon les secteurs et sous bassins versants. Il faut donc arrêter de croire que l’eau qui part en mer est perdue, parce qu'en réalité cette eau est nécessaire pour préserver les milieux aquatiques, leur biodiversité et divers milieux connexes (zones humides, littoral etc.). On voit aussi que les côtes touristiques des grandes retenues d’eau sont déjà compliquées à maintenir sur ce territoire (comme sur celui de la Durance par ailleurs). Le Verdon accueille déjà plus d’1 millions de touristes, principalement en période estivale. S'il y a une volonté régionale d'accroître ce potentiel touristique il va là aussi falloir se poser les bonnes questions pour qu'un équilibre persiste et que celui-ci soit entendu aussi bien d'un point de vue quantitatif que qualitatif et environnemental. A l'image de ce qui est fait actuellement par le PNR du Verdon, il serait donc bien de s'orienter davantage sur une offre touristique tournée vers le respect des milieux aquatiques et de la ressource en eau. Il est également nécessaire de revenir vers une culture méditerranéenne de l'eau et de changer nos modes de vie dans leur globalité (gestion des espaces verts appropriée aux plantes autochtones et à notre climat) afin d'aller vers plus de sobriété toute l'année et pas uniquement imposée par un certain cadre réglementaire lors de période de sécheresse par exemple. Cela peut aussi passer par un plan de communication qui pourrait être mis en place par les producteurs d'eau comme les collectivités territoriales ou encore les distributeurs d'eau (ex. animations réalisées par le PNR Lubéron, audits réalisés auprès des zones d'activités par exemple par la Chambre de Commerce et d'Industrie dans le Var etc.). La sensibilisation de l'ensemble des usagers d'eau potable pourrait être aussi faite par le biais des télé-relevés. De même, une tarification de l'eau pourrait être plus incitative au non-gaspillage de l'eau. Même si la réutilisation des eaux usées ne sera pas aisée partout il est important de l'appréhender quand même dans les divers modèles économiques envisagés. Compte-tenu des impacts qualitatifs et quantitatifs de l'agriculture sur la ressource en eau, il paraît également urgent de modifier en profondeur les pratiques agricoles (pas d'utilisation d'eau potable pour de l'irrigation agricole, restauration écologique des sols, mises en place de variétés moins exigeantes en eau, développement de labels à haute valeur environnementale sur les exploitations agricoles etc.). Sur le cas particulier des retenues, il a été mis en évidence que ce type de substitutions de ressource pose d'autres problèmes et n'en fait donc pas une solution durable. La nécessité d'avoir un bon maillage de SAGE sur les territoires a aussi été abordée puisqu'on se rend vite compte qu'il est plus difficile de faire passer certains messages et d'avoir une gouvernance partagée et concertée lorsqu'on n'a pas de SAGE en place. Enfin, il est sûrement nécessaire de revoir les projets de territoire agricoles autour de l'alimentation plutôt que des plantes médicinales ou encore des vignes beaucoup plus génératrices d'impacts environnementaux et sans valeur ajoutée pour notre alimentation, nos enfants et l'avenir qu'on va leur laisser.
A l'issue de ces ateliers territoriaux, une Feuille de route pour la mission d'animation et de concertation de la Région Sud ainsi qu'une charte révisée ont été présentés au Forum régional de l'Eau qui s'est tenu le 22 Octobre 2019 à Marseille.
- Compte-rendu de l'Atelier Charte Moyenne Durance - Région Sud
- Compte-rendu de l'Atelier Charte Haute Durance - Région Sud
- PPT Effets prévisibles du changement climatique sur les territoires de montagne - Météo France
- Compte-rendu de l'Atelier Charte Rhône Camargue - Région Sud
- Présentation SYMCRAU
- Compte-rendu de l'Atelier Charte Basse Durance - Région Sud
- PPT Présentation du SRADDET et de l'intégration de l'enjeu Eau suite aux propositions faites par AGORA - Région Sud
- Compte-rendu de l'Atelier Charte Métropoles - Région Sud
- Chroniques Compétence Gestion Patrimoniale
- Compte-rendu de l'Atelier Charte Verdon Argens Golfe de Saint Tropez - Région Sud
- Document Golfe de Saint Tropez
- Document SEVE
- En savoir + sur le Forum Régional de l'Eau qui a eu lieu le 22 Octobre 2019 à Marseille