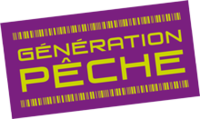Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au site
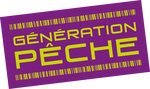
generationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au site
Trouvez les informations pêche de votre département
Accéder au site
cartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au site
La Commission Géographique Littoral PACA Durance
La Commission Géographique regroupe l’ensemble des acteurs de l’eau du périmètre de la Commission Territoriale de bassin, sans être limitée aux seuls membres du Comité de bassin. Le but est de rassembler les élus de l’eau (conseils départementaux et régionaux, services publics d’eau et d’assainissement, établissements publics territoriaux de bassin, structures locales de gestion de bassins versants, usagers économiques et associations…).
Le Président et les Vice-présidents des commissions sont élus par le Comité de bassin.
Actuellement le Président de la Commission Géographique Littoral PACA Durance est Philippe VITEL, Vice-Président de la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur et Président de l'AGORA.
Le Président de l'ARFPPMA PACA, Luc ROSSI, est également l'un des Vices-Présidents de cette Commission.
Retour sur la Commission Géographique Littoral PACA Durance du 7 avril 2023 à Aubagne
L’Agence de l’eau a accueilli les acteurs de l’eau afin de présenter une révision du Plan de Bassin à l’Adaptation au Changement Climatique (PBACC), un plan d’orientation stratégique pour proposer un panier de solution face aux effets du changement climatique sur la ressource en eau. L’Union de Bassin Rhône Méditerranée Corse, les Fédérations de pêche des Bouches-du-Rhône et du Var, l’Association Migrateurs Rhône Méditerranée ainsi que l’Association Régionale se sont mobilisés sur l’évènement pour suivre les présentations le matin et participer à des ateliers à thème l’après-midi.
Après avoir concentré sa première révision autour de 5 enjeux de vulnérabilité (raréfaction de la ressource en eau, assèchement des sols, détérioration de la qualité des eaux, perte de biodiversité aquatique et littorale et risques naturels liés à l’eau comme les inondations), la stratégie s’est tournée vers une atteinte du bon état afin de réduire la sensibilité au changement climatique. Le but étant d’agir plus vite et plus fort à travers plusieurs objectifs de territorialisation des diagnostics de vulnérabilité d’identification des mesures opérationnelles, mais également pour fixer une ambition à la hauteur du changement climatique et faciliter l’appropriation et la sensibilisation.
Une première version du PBACC2 devrait voir le jour d’ici l’été 2023, regroupant une note de stratégie, des principes d’adaptation, un panier de solutions, des objectifs opérationnels et un diagnostic de vulnérabilité des territoires (construit à partir des données attendues de Explore 2070 en cours au niveau national). Le Plan Eau lancé par le président de la République à Savines-le-lac (05) le 30 mars 2023, présente parmi les objectifs une diminution de 10% des prélèvements au niveau national.
Quatre priorités étaient au cœur de ce 11e programme : mieux partager et économiser l’eau ; lutter contre la pollution ; restaurer les milieux aquatiques ; accompagner les collectivités dans ces démarches. Le bilan de ce 11e programme met en avant 39 millions de m3 économisés en Provence-Alpes-Côte d’Azur contre 93 millions de m3 prévus, 21 PTGE mis en place sur tous les territoires en déséquilibre, 15 STEP, 34 km de cours d’eau restaurés sur 190 prévus, 30 hectares de terre désimperméabilisés.
Les mesures mises en place par certaines communes ont également mises en avant, notamment concernant les restrictions appliquées. Un Plan Marshall a été mis en place par la communauté de communes du Pays de Fayence pour faire face à la sécheresse 2022 encadrant l’installation de compteurs intelligents et de limiteurs de débit et la recherche des fuites. L’ensemble des actions réalisées ont permis une diminution de 30% de la consommation d’eau sur le territoire de la communauté de communes.
Le 12e programme pluriannuel devrait être adopté lors d’un Conseil d’Administration en octobre 2024. Un Plan Eau de planification économique a vu le jour, doté de 53 mesures pour organiser la sobriété, optimiser les usages, préserver la qualité de l’eau et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques. Ce Plan Eau informe aussi sur les moyens mis en œuvre en termes de gouvernance et de financements.
Une suppression des primes pour l’épuration et des réformes sur les redevances devraient avoir lieu. Des réflexions sont en cours concernant la suppression des redevances de pollutions domestiques, la modernisation des réseaux de collecte et la création de nouvelles redevances « eau potable » pour tous les usagers et « assainissement » avec des volets incitatifs. Il est également réfléchi à la création d’une redevance « biodiversité » portée par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité. En revanche, il est encore nécessaire de trouver de nouveaux moyens de financements pour répondre aux enjeux du Plan Eau ministériel.
Les priorités d’action actuelles sont tournées autour du partage et de la gestion de la ressource en eau par le biais du PTGE, des économies d’eau et de la substitution si nécessaire toujours par le biais du PTGE.
Des réflexions ont également été engagées afin d’aider plus efficacement pour une diminution de l’équilibre quantitatif, d’aider à plus de sobriété en eau et afin de rendre les territoires moins vulnérables, et pour prendre en compte la ressource disponible.
Concernant les milieux aquatiques en particulier, la réflexion est tournée sur la mobilisation des territoires, la favorisation des démarches intégrées et l’augmentation de l’ambition des projets de restauration.
Retour sur la Commission Géographique Littoral PACA Durance du 12 Avril 2021 en visioconférence
Compte-tenu de la situation sanitaire liée à la covid19, cette Commission a eu lieu en visioconférence mais a quand même permis de réunir plus de 250 personnes, soit autant qu'en présentiel.
Suite notamment à l'adoption du projet de SDAGE 2022-2027 en Comité de Bassin en Septembre 2020, cette Commission avait pour objectifs de rappeler l'objet et les grandes étapes d'élaboration des projets de SDAGE-PDM et PGRI et de présenter les modalités de consultation sur le projet de SDAGE 2022-2027 et son Programme de mesures, lancée le 1er mars 2021.
Par ailleurs, 2 "zooms" ont été faits sur la gestion quantitative de la ressource en eau (présentation mise en oeuvre du PGRE Caramy-Issole par le Syndicat mixte de l'Argens) et la restauration des cours d'eau en lien avec la prévention des inondations (présentation du projet de restauration du Haut Drac par la CLEDA) afin de montrer les dynamiques en cours sur le territoire concernant ces thématiques là, par présentation de retours d'expériences mis en oeuvre par les acteurs territoriaux.
Pour cette occasion, le Président de l'ARFPPMA PACA, Monsieur Luc ROSSI, était aux côtés du Président de la Commission Géographique Littoral PACA Durance, Monsieur Philippe VITEL, en sa qualité de Vice-Président.
Pour votre bonne information, vous retrouverez ci-dessous la position de notre Association Régionale sur les 3 principaux points à l'ordre du jour de cette séance :
- En ce qui concerne le projet de SDAGE 2022-2027 : notre réseau associatif, bien représenté au sein du Comité de Bassin, a voté favorablement en faveur du projet de SDAGE présenté en Septembre de l'année dernière car à notre sens c'est l'OUTIL pertinent pour garantir et maintenir une gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l'échelle des grands bassins hydrographiques français, cette gestion de l'eau nous étant enviée dans bien d'autres pays notamment d'Europe.
Nous soutenons donc fermement ce projet de SDAGE qui reste, à l'image du précédent SDAGE, ambitieux sur différentes thématiques comme notamment la restauration hydromorphologique ou encore la bonne intégration entre enjeux de prévention d'inondations et gestion des milieux aquatiques. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir que certaines dispositions et orientations fondamentales du précédent SDAGE ont également été renforcées comme par exemple l'aspect préservation et non-dégradation des milieux aquatiques que notre réseau associatif appelait de ses voeux depuis de nombreuses années, ou encore la réduction des impacts des éclusées, comme l'adaptation au changement climatique par une priorisation du changement des pratiques agricoles (y compris du choix des variétés culturales) plutôt qu'un recours systématique à des ressources de substitution qui ne seront selon nous qu'une fuite en avant. Nous sommes également satisfaits de voir que la préservation des réservoirs biologiques et de leurs fonctionnalités sera renforcée, car ce seront effectivement des remparts contre le changement climatique et nous ne pouvons que malheureusement constater actuellement qu'ils sont souvent mis à mal par la micro et pico hydroélectricité notamment dans nos Alpes. Nous y serons donc particulièrement attentifs et espérons que notre réseau associatif sera bien associé à la révision de ces derniers dans le cadre de ce nouveau SDAGE. Enfin, nous regrettons que la gestion de crise sécheresse n'ait pas été ajoutée au projet de SDAGE à l'instar de ce qui est en train d'être étudié dans le projet de décret gestion quantitative de la ressource en eau et de crise sécheresse notamment. Car nous sommes persuadés que la gestion structurelle à long terme de la ressource en eau ne pourra en effet montrer des effets positifs que si les épisodes de crise sont également gérés de manière efficace.
Quant au Programme de Mesures, nous espérons qu'il restera suffisamment ambitieux également afin qu'un nombre important d'actions puissent voir le jour et permettre d'atteindre les objectifs fixés pour la DCE en 2027. De ce point de vue-là et sans avoir encore tout analysé, nous nous interrogeons notamment sur l'absence de mesures prises sur la Durance notamment pour cette période alors même qu'un certain nombre d'actions (notamment de restauration écologique) sont engagées pour la période 2022-2027. Nous espérons que ces actions ne seront donc pas reportées à cause d'objectifs reportés à post 2027.
Dans tous les cas, pour la 1ère fois notre réseau associatif est consulté au titre des Assemblées et nous ne pouvons qu'en remercier l'Agence de l'Eau RMC. Nous savons que l'ensemble du réseau associatif prendra le temps nécessaire pour répondre à cette consultation d'envergure pour notre région et plus globalement pour le bon état de nos cours d'eau en France.
- En ce qui concerne le 1er zoom et la présentation du REX sur la mise en oeuvre du PGRE Caramy-Issole par le Syndicat mixte de l'Argens : nous espérons que ce Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Caramy-Issole sera ambitieux et permettra de retrouver un équilibre entre ressource en eau et prélèvements sur ce secteur déficitaire car ces rivières possèdent notamment un peuplement piscicole remarquable qu'il est important de préserver au regard des enjeux de Biodiversité aquatique. Des assecs sont continuellement avérés chaque année sur ces cours d'eau, entraînant souvent de la mortalité piscicole et on constate malheureusement une accélération ces dernières années comme en témoigne l'année 2020 qui a vu près de 80% du linéaire de l'Issole en assec entre Août et Décembre (soit en pleine période de reproduction de la Truite Fario, espèce repère de ce cours d'eau) et notamment sur une partie du cours d'eau pourtant classé en Réservoir Biologique et avec malheureusement encore qu'un simple stade de vigilance enclenché en gestion de crise sécheresse sur ce bassin versant cette année-là. En 2021, et sans présager de l'effet des pluies de ce week-end tant attendu, les débits de ces cours d'eau sont déjà similaires à des débits d'étiage que l'on constate normalement en plein été... Il est donc important que l'aspect gestion de crise sécheresse soit également bien appréhendé dans le Plan de Gestion de la Ressource en Eau ou en tout cas de manière complémentaire afin que les efforts réalisés dans ce cadre là ne pâtissent pas d'une mauvaise gestion de crise.
- En ce qui concerne le 2ème zoom et le REX sur la restauration du Haut Drac présenté par la CLEDA : ce qui a été mis en oeuvre sur le territoire de la CLEDA est vraiment un exemple sur lequel les autres projets régionaux devront s'appuyer tant dans la manière d'appréhender le projet (bonne intégration de l'ensemble des parties prenantes au projet) que par l'ampleur des travaux réalisés tout en travaillant autant sur la GEMA que la PI. Gageons que cet exemple puisse être suivi notamment sur le territoire des Alpes Maritimes qui doit faire face actuellement aux conséquences de la tempête Alex sur les vallées notamment de la Roya et de la Vésubie avec la mise en place de travaux d'urgence, mais qui, au regard de ce que peut constater notre réseau associatif, ne mettent actuellement pas assez à notre sens l'accent sur prévention des inondations ET gestion des milieux aquatiques (bulldozers retirant des blocs entiers d'enrochement directement dans la Roya, la Vésubie et parfois même dans la Tinée qui, d'un point de vue hydrobiologique, a été plutôt épargnée par la tempête Alex etc.). Nous espérons véritablement que les services de l'Etat seront attentifs à ces futurs projets pharaoniques de reconstruction et de prévention de nouvelles inondations afin de ne pas reproduire les erreurs du passé et de faire en sorte d'avoir des vallées plus résistantes naturellement à ces phénomènes extrêmes qui ne risquent que de s'accroître et s'intensifier dans le futur.
Retour sur la Commission Géographique Littoral PACA Durance du 2 Décembre 2019
Cette journée a été organisée dans le but de poursuivre le travail déjà engagé de préparation du SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027 dont le Comité de Bassin adoptera le projet en juin 2020 avant une large phase de consultation institutionnelle et du public.
Afin de répondre à ces objectifs, la Commission Géographique s'est déroulée en deux temps :
- la matinée a été consacrée à la présentation du bilan de la mise en oeuvre du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 sur le territoire et des enjeux sur lesquels le SDAGE 2022-2027 devra apporter des réponses, à savoir prioritairement sur :
° la gestion équilibrée de la ressource en eau dans le contexte de changement climatique ;
° la lutte contre les pollutions par les substances dangereuses ;
° la restauration des cours d'eau en lien avec la prévention des inondations ;
- l'après-midi, des espaces thématiques participatifs ont permis de réagir par écrit sur les axes d'évolution envisagés pour le SDAGE 2022-2027 et présentés ci-dessus.
Retour sur les présentations et interventions de la matinée :
S. BARTHELEMI (VP Métropôle MPM) : annonce la labellisation EPAGE du Syndicat de l’Huveaune qui assure la compétence GEMAPI pour la Métropole MPM sur son territoire (taxe GEMAPI levée). La prochaine phase du contrat de rivière de l’Huveaune a été approuvée et le PAPI est en cours de finalisation. L'inauguration du parc de la confluence (avec réduction du risque d’inondation sur une rive en lien avec protection sur l’autre rive et mise en place d'une voie verte) a bien eu lieu. L'aménagement du territoire est pensé sur ce territoire là en intégrant bien la thématique de l'eau et de la nécessaire désimperméabilisation des sols. Il est toutefois nécessaire également de prévoir une nouvelle gestion du pluvial afin de lutter contre le ruissellement et la pollution diffuse puisque jusqu’à présent tout partait dans l’Huveaune.
P. VITEL (Président de la Commission Géographique Littoral PACA Durance et VP de la Région Sud) : excuse M. SADDIER (Président du Comité de Bassin) retenu par ailleurs. Il précise que les décisions prises au Comité de Bassin doivent correspondre aux attentes des territoires, d’où l’importance des échanges en Commission Géographique Littoral PACA Durance. Il rappelle les différents temps de travail en concertation qui ont eu lieu tout au long de l'année (sur la définition des pressions identifiées au futur SDAGE au printemps puis sur le programme de mesure afin d'identifier les mesures pertinentes à prévoir sur les masses d'eau prioritaires pour lever ces pressions). Aujourd'hui, c'est sur les orientations fondamentales du futur SDAGE que l'on nous demande de travailler en concertation, en sachant que ce qui est d'ores et déjà proposé est de ne pas revenir sur les orientations fondamentales identifiées au SDAGE actuel mais de mettre l'accent sur 3 sujets majeurs à savoir la gestion qualitative et quantitative de l'eau et la restauration hydromorphologique en lien avec la prévention des inondations. Il rappelle les actions engagées en région Provence Alpes Côte d'Azur : 15 PGRE adoptés (les 6 derniers devraient l'être en 2020) - 100 millions de mètres cube d'eau économisés ou substitués - 75 km de travaux structurant de restauration physique des cours d'eau - 66 captages identifiés comme prioritaires dont 600% avec un plan d'action validé en cours de mise en oeuvre. L'enjeu majeur du futur SDAGE sera donc de maintenir cette dynamique et de la rendre aussi encore plus efficiente.
L. ROY (Directeur Général de l'Agence de l'Eau RMC) : il rappelle que le futur SDAGE doit bien être bâti sur l'existant tout en le réactualisant principalement autour des 3 enjeux majeurs évoqués par Monsieur VITEL. La mobilisation collective a permis de faire déjà pas mal de choses, il était donc important de revenir sur tout ce que nous avions acquis en 50 ans et de focaliser nos actions sur ce qu’il reste à faire encore à l’avenir.
H. SOUAN (Chef de service DREAL PACA) : rappelle quant à elle que l'on est à un moment charnière entre bilan du SDAGE actuel et élaboration du futur. Le but aujourd'hui est donc de bien de se ré-interroger et d'enrichir tout ce qui s’est déjà dit tant sur l’analyse des pressions que des actions envisagées pour les réduire.
Présentation de la situation du bassin Rhône Méditerranée et du territoire régional :
En 2019 :
A l'échelle du territoire Rhône Méditerranée : 35% des masses d'eau sont considérées en bon état, contre 31% en état moyen, 20% en état médiocre, 12% en très bon état et 2% en mauvais état. On constate une relative stabilité sur le long terme.
A l'échelle Provence Alpes Côte d'Azur : 40% des masses d'eau sont considérées en bon état, contre 25% en état moyen, 23% en très bon état, 10% en état médiocre, 2% en mauvais état. Sur le long terme, on constate une amélioration des éléments de qualité constitutifs de l’état.
RNAOE à l’échelle du territoire Rhône Méditerranée : 359 masses d'eau sont en RNAOE pour 2021 et 375 pour 2027 (soit 53% en RNAOE en 2027).
RNAOE à l’échelle Provence Alpes Côte d'Azur : les principales pressions dans la région sont l'altération morphologique des masses d'eau, la discontinuité écologique et la modification du régime hydrologique des masses d'eau au regard du changement climatique et aggravée par la pression de prélèvements en eau multi-usages car finalement RNAOE assez stable sur le long terme malgré ce qui a déjà été fait. Par contre, même si pas en pressions majeures par rapport aux autres items on s’aperçoit que les RNAOE explosent aussi sur le volet qualitatif, notamment au regard de la pollution par les pesticides et nutriments agricoles.
A. MIEVRE (Directrice de la Délégation PACA & Corse de l'Agence de l'Eau RMC) fait ensuite état des progrès accomplis sur la gestion équilibrée de la ressource à l’échelle Rhône Méditerranée avec zoom territorial. Une forte dynamique est en cours sur la mise en oeuvre des PGRE. Vis à vis de l'eau potable, ces actions participent visiblement à contenir la hausse des pressions de prélèvement dus à une augmentation de la population.
Ex. BV Asse – PGRE depuis 2016 – diminution des prélèvements en période d’étiage recherché – MO ASL des canaux de Gion et du Moulin – travaux de busage et modernisation d’une partie des canaux afin d’économiser 17% d’eau prélevés pour 47 000 euros pris en charge par fonds publics à hauteur de 90% !
Il existe aussi une bonne dynamique en matière de restauration de la continuité écologique puisque les opérations de décloisonnement sur les ouvrages prioritaires de la Liste 2 s'accélèrent ces dernières années en Provence Alpes Côte d'Azur. Pour autant, il reste encore 120 ouvrages prioritaires à traiter dans la région !
Enfin, en termes de linéaire de cours d'eau restauré, la région Provence Alpes Côte d'Azur comptabilise 25 km pour 330 km à l'échelle du bassin Rhône Méditerranée. Des efforts restent donc encore à mener même si l'appropriation de la notion d'Espace de Bon Fonctionnement (EBF) se fait de mieux en mieux : 18 EBF validés sur le territoire Rhône Méditerranée dont 6 en Provence Alpes Côte d'Azur et 26 EBF en cours dont 15 en Provence Alpes Côte d'Azur.
Ex. coût du parc des confluences sur l’Huveaune : 960 000 euros de travaux pris en charge à 70% par AE RMC – 20% Ville d’Auriol et 10% Syndicat de l’Huveaune. Par réponse à l’appel à projet GEMAPI - Réduction du risque inondation efficace pour la décennale puisque vu les crues de ces 15 derniers jours pas de constat d’inondation des riverains. Retour très positif de l’aménagement par les riverains.
Intervention P. LEVEQUE (Président de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et Vice-Président de la Commission Géographique en remplacement d'A. BERNARD) : demande à ce que le futur SDAGE intègre bien tous les efforts déjà réalisés par les agriculteurs sur les économies d'eau comme l'usage des pesticides notamment, car il juge que le monde agricole a déjà fait beaucoup et qu'au risque de ne plus s'y retrouver économiquement parlant il ne pourra guère faire mieux. Il demande également des financements supplémentaires pour aider les agriculteurs qui peuvent encore faire des efforts à les faire, et notamment à ce que les chambres départementales d'agriculture puissent intervenir sur les nouvelles aides prévues pour les agriculteurs, à savoir sur les PSE (Paiements pour Services Environnementaux).
Intervention L. FONTICELLI (Trésorier ARFPPMA PACA et Président FD du Var) afin d'excuser l'absence de Luc ROSSI (Président de l'ARFPPMA PACA et Vice-Président de la Commission Géographique) et de partager son avis sur le sujet (cf. note en pièce jointe).
Intervention FNE PACA pour conforter notre discours et positionnement.
Présentation des enjeux du SDAGE 2022-2027 et des grands axes d’évolution :
Rappel du calendrier et de la méthode d’élaboration du SDAGE : courant 2020 : adoption des projets de SDAGE et PDM 2022-2027 avec consultation de l’autorité environnementale pour été 2020.
Novembre 2020 à Avril 2021 : recueil des observations du public et des assemblées aux projets de SDAGE et PDM 2022-2027 - Fin 2021 : adoption du SDAGE et PDM 2022-2027 et en même temps échéance pour l’atteinte des objectifs du SDAGE 2016-2021.
Présentation synthétique des contributions des Groupes de Travail du Comité de Bassin sur les 3 thèmes identifiés préalablement et téléchargeables ci-dessous :
- Points de débat appelant des pistes d’évolution sur la gestion équilibrée de la ressource en eau au regard du changement climatique :
° Portée réglementaire des PGRE : intégrer les PGRE (leurs objectifs) dans les SAGE ;
° Renforcer la disposition sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
° Articulation entre restauration de l’équilibre quantitatif et besoins de développement des usages (préoccupation dominante) ;
° Nécessité d’avoir des PGRE évolutifs ;
° Préciser l’articulation PTGE/PGRE.
- Points de débat appelant des pistes d’évolution sur la lutte contre les pollutions par les substances dangereuses :
° Nécessité de développer des approches territoriales pour réduire les rejets et émissions de substances pour diminuer l’imprégnation des milieux et les flux à la mer ;
° Avoir des approches territoriales plus intégrées ;
° Aller au-delà des seules substances surveillées au titre de la DCE et caractériser l’impact des substances en s’appuyant sur les outils bio de plus en plus opérationnels pour des diagnostics locaux plus fins ;
° Mobiliser les différents outils existants (notamment réglementaires et/ou incitatifs) pour les différentes activités concernées ;
° Développer la sensibilisation du grand public dans le cadre de ces démarches pour des usages domestiques plus sobres et durables aussi ;
° Importance majeure de l’animation de ces approches territoriales ;
° Rechercher la complémentarité entre prévention à la source et traitement des rejets pour réduire les pollutions concentrées par les agglomérations (approche coût/efficacité) ;
° Promouvoir le développement de traitements épuratoires plus poussés sur certains territoires les plus fragiles vis-à-vis des pollutions par les substances dangereuses en fonction de la nature des polluants (analyse coût/efficacité).
- Points de débat appelant des pistes d'évolution sur la restauration morphologique des cours d'eau en lien avec la prévention des inondations :
° Dynamique de mobilisation engagée mais qui doit monter en puissance ;
° Bénéfices multiples ;
° Renforcer la culture GEMAPI et celle du risque auprès de la population et des élus (multiplier les REX, développer des outils de communication permettant de visualiser les projets et leurs effets…) ;
° Nécessité de cibler les actions les plus efficaces à l’échelle des BV sans attendre la prise de conscience post-événement ;
° Renforcer la structuration de la compétence GEMAPI à l’échelle des BV ;
° Promouvoir les outils de compensation financière existants pour les sur-inondations ;
° Mobiliser les EBF pour la prévention des inondations, notamment en lien avec les PAPI ;
° Etudier plusieurs scénarios prenant en compte les bénéfices socio-économiques et environnementaux pour définir les programmes de travaux en intégrant notamment les solutions fondées sur la nature (efficientes, résilientes, moins interventionnistes).
- Téléchargez la note Starter du Comité de Bassin sur la gestion équilibrée de la ressource en eau dans le contexte de changement climatique
- Téléchargez la note Starter du Comité de Bassin sur la lutte contre les pollutions par les substances dangereuses
- Téléchargez la note Starter du Comité de Bassin sur la restauration des cours d'eau en lien avec la réduction de l'aléa d'inondation
- Téléchargez notre intervention à la Commission Géographique Littoral PACA Durance
Retour sur la Commission Géographique Littoral PACA Durance du 7 Février 2019
Cette Commission qui a fait salle comble à Septème-les-Vallons, était en grande partie consacrée à la présentation du XIème programme de l'Agence de l'Eau RM&C.
Elle a également permis de faire un bilan à mi-parcours du programme de mesures du SDAGE 2016-2021 et de mettre en lumière certains projets qui ont pu être réalisés grâce à un soutien financier conséquent de l'Agence de l'Eau RM&C.
Enfin, l'après-midi, un espace d'informations était mis à disposition des participants avec des référents thématiques qui étaient là pour pouvoir répondre aux questions relatives aux aides prévues dans le cadre de ce XIème programme.
L'ouverture de la Commission a été faite par son Président, Philippe VITEL, qui a entre autres évoqué les contributions et motions prises en AGORA en faveur du fonctionnement des Agences de l'Eau et du principe d'une gestion intégrée à l'échelle des bassins versants, la tournée des territoires qui va être entreprise en région Provence Alpes Côte d'Azur dans le but de renouveler la charte régionale de l'eau, le Forum régional de l'eau qui devrait se tenir en Juin ou Septembre 2019 et qui viendra clôturer ce temps fort autour du renouvellement de la charte régionale de l'eau, ou encore l'engagement pris par la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur d'agir en faveur de l'eau et des milieux aquatiques à travers le décret ministériel demandé et obtenu sur la délégation d'une mission d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
A cette occasion, le Président du Comité de bassin Rhône Méditerranée, Martial SADDIER, Député et Conseiller régional Auvergne Rhône Alpes, nous a fait l'honneur de sa présence. Il a tenu des propos forts comme son engagement pour minimiser au maximum les ponctions budgétaires de l'Etat sur le fonctionnement des Agences de l'Eau, pour que notre modèle français de l'eau soit préservé (que le principe pollueur-payeur soit préservé et que l'eau continue à ne payer que l'eau), ou encore pour que la vision de gestion intégrée par bassin versant soit la bonne échelle de gestion de l'eau.
Il pense que nous devons collectivement rester très prudent sur le devenir de ces ponctions budgétaires et donc sur le fonctionnement des Agences de l'Eau qui peut être remis à mal à chaque nouvelle loi des finances. Pour cela, il rappelle qu'il est très important de monopoliser la totalité des aides accordées par l'Agence de l'Eau RM&C et d'être au plus juste entre prévisionnel et action afin de ne pas "bancariser" de l'argent prévu pour des projets qui n'ont pu aboutir dans les caisses des Agences de l'Eau.
Il pense également qu'il est important de bien faire connaitre et reconnaitre les missions des Agences de l'Eau, des Comités de bassin, véritables Parlements de l'eau, et de bien mettre en évidence tous les projets qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier des Agences de l'Eau.
Enfin, il demande à ce que les différents organismes présents ce jour pensent à convier plus souvent leurs élus parlementaires (Sénateurs et Députés) à leurs différents temps forts ou inaugurations afin qu'il y ait un maximum d'élus parlementaires qui se saisissent de ces différentes problématiques.